
Le texte qui suit est le premier chapitre d'un essai inédit dont je suis l'auteur. Il s'intitule Le syndrome de la vache sacrée et a pour thème la condition masculine.
Olivier Kaestlé
Il y a un certain temps, un article sur la réussite scolaire au féminin m’avait laissé songeur. Il y était question de la façon dont on avait corrigé en Grande-Bretagne le retard des filles sur les garçons en mathématiques. J’ai d’abord été surpris - et ravi, dans notre société obnubilée par la promotion de la femme - de constater qu’un tel propos reconnaissait implicitement que les garçons détenaient une longueur d’avance sur les filles en maths. Cette réalité était jadis considérée comme un axiome dans la différenciation des aptitudes respectives des deux sexes en éducation.
Nombreux ont eu vent de cette théorie selon laquelle l’hémisphère droit du cerveau des garçons, voué à la résolution des problèmes spatiaux et mathématiques, serait plus développé que celui des filles. De nos jours, évoquer cette théorie pourrait vous attirer des accusations de sexisme ou de misogynie.
Par contre, d’aucuns endosseront sans problème que les filles, dont l’hémisphère gauche serait plus développé que celui des garçons, disposent pour cette raison de plus grandes aptitudes langagières et rédactionnelles. Personne alors ne vous sautera à la gorge si vous énoncez ce précepte. Il est à la page.
Il y a un certain temps, un article sur la réussite scolaire au féminin m’avait laissé songeur. Il y était question de la façon dont on avait corrigé en Grande-Bretagne le retard des filles sur les garçons en mathématiques. J’ai d’abord été surpris - et ravi, dans notre société obnubilée par la promotion de la femme - de constater qu’un tel propos reconnaissait implicitement que les garçons détenaient une longueur d’avance sur les filles en maths. Cette réalité était jadis considérée comme un axiome dans la différenciation des aptitudes respectives des deux sexes en éducation.
Nombreux ont eu vent de cette théorie selon laquelle l’hémisphère droit du cerveau des garçons, voué à la résolution des problèmes spatiaux et mathématiques, serait plus développé que celui des filles. De nos jours, évoquer cette théorie pourrait vous attirer des accusations de sexisme ou de misogynie.
Par contre, d’aucuns endosseront sans problème que les filles, dont l’hémisphère gauche serait plus développé que celui des garçons, disposent pour cette raison de plus grandes aptitudes langagières et rédactionnelles. Personne alors ne vous sautera à la gorge si vous énoncez ce précepte. Il est à la page.
Par ailleurs, de récentes études tendraient à démontrer qu’à l’échelle mondiale, les filles réussissent aussi bien que les garçons en maths tandis que ces derniers tirent toujours de la patte en langage et en rédaction. Comment expliquer ce phénomène ? L’hémisphère droit des filles serait-il plus stimulable que l’hémisphère gauche des garçons ?
L’avocat du diable pourrait se demander si le fait pour les filles d’afficher un score comparable à celui des garçons en maths implique nécessairement qu’elles soient aussi douées pour cette discipline. « Bien sûr que oui! » répondraient avec emphase des représentantes de groupes de femmes. Une performance équivalente implique-t-elle vraiment une compétence égale ?
L’article que je lisais n’avait cependant pas pour but de camper le débat sous cet angle. En fait, il faisait plutôt l’éloge de l’esprit novateur du ministère de l’Éducation britannique, qui avait su endiguer avec brio les « barrières » qui entravaient jusqu’alors les filles dans leur quête de réussite.
Deux « innovations » avaient de quoi laisser songeur. La première voulait qu’on mette de côté les compétitions orales de calcul mental, qui laissaient plus souvent qu’autrement les filles perdantes, en plus de leur attirer les quolibets de leurs confrères masculins.
La seconde diminuait la pression sur les filles en cessant d’exiger la bonne réponse à tout prix dans la résolution des problèmes mathématiques. L’ « ingéniosité » et la « recherche » dans l’élaboration des solutions étaient désormais prises en considération dans l’évaluation de leur rendement, indépendamment qu’elles aboutissaient à une réponse exacte ou erronée.
Il serait intéressant de déterminer si ce genre de «trouvailles » appliquées à la façon d’enseigner les mathématiques ne sont pas à l’origine de la réussite dite égale des filles, à l’échelle mondiale.
Précisons toutefois que, malgré un contexte facilitant, l’apprentissage des mathématiques demande aux filles beaucoup plus d’efforts qu’aux garçons, en plus de leur occasionner davantage de stress. De plus, à partir du secondaire, les filles disparaissent de façon notable des options et des concentrations vouées aux mathématiques et aux sciences pures et appliquées.
Dans cette optique, ces initiatives éducatives, qui se résument à réduire le degré de difficulté de l’enseignement des mathématiques, et à valoriser tant bien que mal le travail des filles, aident-elles véritablement ces dernières dans leur apprentissage ? Leur ouvrent-elles des portes aux niveaux secondaire, collégial et universitaire ?[1] Ne risquent-elles pas plutôt de leur donner un faux sentiment de confiance en leurs possibilités ? D’un autre côté, le retour à des standards « masculins » ne risque-t-il pas effectivement de leur rendre les maths encore plus indigestes que maintenant ? Dilemme…
La partie est loin d’être gagnée pour les filles en mathématiques si l’on en juge par des chiffres récents qui révèlent qu’au Québec, malgré une surreprésentation générale des filles aux niveaux collégial et universitaire, la domination des garçons demeure très forte, non seulement en mathématiques, mais également en sciences pures et appliquées et en informatique avec des pourcentages oscillant entre les 65 et les 75 %.
Et l’on parle d’un contexte où, à ce qu’il paraît, ça va mal pour les garçons… Curieux qu’une telle réussite masculine ne soit pas reconnue plus ouvertement. Que voulez-vous ? Semblable reconnaissance pourrait être perçue par les regroupements de condition féminine comme portant ombrage au développement des filles et serait sans doute interprétée comme une valorisation d’un stéréotype sexiste.
Bref, quand les garçons réussissent, c’est grâce à un contexte qui désavantage les filles et quand les filles réussissent, c’est par leur travail opiniâtre et leur conscience professionnelle indéfectible. Le fait que depuis plus de trente-cinq ans, sous la poussée du lobby féministe, les milieux de l’éducation n’aient cessé d’adapter les lieux d’apprentissage aux besoins spécifiques des filles n’est jamais avancé très hardiment comme un facteur expliquant leur succès.[2]
Quant aux garçons, on a vite fait de leur jeter la pierre et d’accuser leur manque de motivation. Ce faisant, on les rend responsables de la faillite d’un système et leur place sur les épaules un fardeau injustifiable qui ne leur incombe pas. Ce double standard ne contribuera pas davantage à prévenir leur décrochage, au cas où cette question préoccuperait encore quelqu’un au MÉQ.[3]
L’avocat du diable pourrait se demander si le fait pour les filles d’afficher un score comparable à celui des garçons en maths implique nécessairement qu’elles soient aussi douées pour cette discipline. « Bien sûr que oui! » répondraient avec emphase des représentantes de groupes de femmes. Une performance équivalente implique-t-elle vraiment une compétence égale ?
L’article que je lisais n’avait cependant pas pour but de camper le débat sous cet angle. En fait, il faisait plutôt l’éloge de l’esprit novateur du ministère de l’Éducation britannique, qui avait su endiguer avec brio les « barrières » qui entravaient jusqu’alors les filles dans leur quête de réussite.
Deux « innovations » avaient de quoi laisser songeur. La première voulait qu’on mette de côté les compétitions orales de calcul mental, qui laissaient plus souvent qu’autrement les filles perdantes, en plus de leur attirer les quolibets de leurs confrères masculins.
La seconde diminuait la pression sur les filles en cessant d’exiger la bonne réponse à tout prix dans la résolution des problèmes mathématiques. L’ « ingéniosité » et la « recherche » dans l’élaboration des solutions étaient désormais prises en considération dans l’évaluation de leur rendement, indépendamment qu’elles aboutissaient à une réponse exacte ou erronée.
Il serait intéressant de déterminer si ce genre de «trouvailles » appliquées à la façon d’enseigner les mathématiques ne sont pas à l’origine de la réussite dite égale des filles, à l’échelle mondiale.
Précisons toutefois que, malgré un contexte facilitant, l’apprentissage des mathématiques demande aux filles beaucoup plus d’efforts qu’aux garçons, en plus de leur occasionner davantage de stress. De plus, à partir du secondaire, les filles disparaissent de façon notable des options et des concentrations vouées aux mathématiques et aux sciences pures et appliquées.
Dans cette optique, ces initiatives éducatives, qui se résument à réduire le degré de difficulté de l’enseignement des mathématiques, et à valoriser tant bien que mal le travail des filles, aident-elles véritablement ces dernières dans leur apprentissage ? Leur ouvrent-elles des portes aux niveaux secondaire, collégial et universitaire ?[1] Ne risquent-elles pas plutôt de leur donner un faux sentiment de confiance en leurs possibilités ? D’un autre côté, le retour à des standards « masculins » ne risque-t-il pas effectivement de leur rendre les maths encore plus indigestes que maintenant ? Dilemme…
La partie est loin d’être gagnée pour les filles en mathématiques si l’on en juge par des chiffres récents qui révèlent qu’au Québec, malgré une surreprésentation générale des filles aux niveaux collégial et universitaire, la domination des garçons demeure très forte, non seulement en mathématiques, mais également en sciences pures et appliquées et en informatique avec des pourcentages oscillant entre les 65 et les 75 %.
Et l’on parle d’un contexte où, à ce qu’il paraît, ça va mal pour les garçons… Curieux qu’une telle réussite masculine ne soit pas reconnue plus ouvertement. Que voulez-vous ? Semblable reconnaissance pourrait être perçue par les regroupements de condition féminine comme portant ombrage au développement des filles et serait sans doute interprétée comme une valorisation d’un stéréotype sexiste.
Bref, quand les garçons réussissent, c’est grâce à un contexte qui désavantage les filles et quand les filles réussissent, c’est par leur travail opiniâtre et leur conscience professionnelle indéfectible. Le fait que depuis plus de trente-cinq ans, sous la poussée du lobby féministe, les milieux de l’éducation n’aient cessé d’adapter les lieux d’apprentissage aux besoins spécifiques des filles n’est jamais avancé très hardiment comme un facteur expliquant leur succès.[2]
Quant aux garçons, on a vite fait de leur jeter la pierre et d’accuser leur manque de motivation. Ce faisant, on les rend responsables de la faillite d’un système et leur place sur les épaules un fardeau injustifiable qui ne leur incombe pas. Ce double standard ne contribuera pas davantage à prévenir leur décrochage, au cas où cette question préoccuperait encore quelqu’un au MÉQ.[3]
[1] Cette orientation devait entraîner un nouveau nivellement vers le bas, en 2009, dans l’enseignement des mathématiques. Voici le texte que cette « innovation » m’avait inspiré l'année qui avait précédé :
Alors que le milieu de l’Éducation n’a toujours pas résolu ses différends entourant la réforme, l’improvisation rivalise avec la précipitation quant à la mise en place de trois nouvelles options de mathématique, prévues dès septembre prochain, en quatrième secondaire. La confusion est telle que la Fédération des syndicats de l’enseignement a déjà sommé le ministère de l’Éducation de reporter le nouveau programme. En effet, les trois nouvelles séquences, soit Culture, société et technique, Techno-sciences et Sciences naturelles, devraient, autrement, remplacer les cours de maths 416, 426 et 436.
Cette orientation pédagogique semble d’autant plus aventureuse qu’il s’en dégage des relents d’une réforme dont nombreux affirment depuis un bon moment qu’il faudra, soit la réformer, soit l’abandonner, devant le recul académique de nos élèves. Rappelons que la Suisse, dont notre ministère s’est malencontreusement inspiré, est revenue à des formules traditionnelles de cours magistraux et d’acquisition de connaissance.
Les lunettes roses resteront toutefois de mise, puisque les séquences prévues tableront sur les intérêts des élèves plutôt que sur leurs forces et faiblesses. L’approche décontractée et non-compétitive, si décriée, a toujours la cote. Une pensée magique y préconise de présumées compétences, développées de façon zen et auto-motivante. L’acquisition de connaissances sera vraisemblablement assujettie à ce plan de match.
La différence marquée de contenu des trois options empêchera de nombreuses écoles de toutes les offrir. Certains élèves seront ainsi contraints de changer d’établissement pour suivre la séquence de leur choix. Des parents redoutent que l’école de leurs enfants ne se vide de ses meilleurs éléments. N’a-t-on pas déjà accusé la réforme de niveler par le bas ?
Les mathématiques restant le passage obligé pour les programmes collégiaux de sciences pures, n’assiste-t-on pas à une tentative désespérée de former des scientifiques de fortune en diminuant les exigences ? Préfère-t-on la quantité à la qualité ? Le MÉQ ressemble fortement à un père de famille, qui rêve de transformer son gamin en champion de hockey, quand ce dernier aspire plutôt à devenir psychologue.
Des chiffres récents de ce ministère révélaient, dans cette optique, qu’en 2006, les filles ne représentaient toujours que 25 % des inscriptions universitaires en sciences appliquées et 16,3 % des élèves en ingénierie. Est-ce, notamment, pour remédier à cette faible représentation scientifique, confirmée étude après étude, que l’on crée ce branle-bas de combat ? Après tout, ce ne serait pas le première fois que le Conseil du statut de la femme, obsédé depuis 35 ans par le virage scientifique des filles, influerait sur les politiques ministérielles en éducation, comme ailleurs. La ministre Courchesne, jadis à la Condition féminine, demeurerait, dans cette perspective, une alliée stratégique de choix.
Si cette hypothèse s’avère exacte, peu gagneront au change. Sans réelle motivation, les filles déserteront peut-être les maths un peu plus tard. Nous assisterons malgré tout à une autre initiative vide de sens, semblable au programme Chapeau les filles, obstinément reconduit. À l’école, comme au Conseil des ministres, favoriser les aptitudes sans discrimination, même positive, restera toujours préférable à mousser une parité homme-femme cosmétique.
La parité à tout prix, Olivier Kaestlé, Cyberpresse, 28 mai 2008.
Ceux et celles qui croient que le féminisme est en déclin ou même, vestige d’un passé révolu, devraient se raviser. L’impact du Conseil du Statut de la femme sur la machine gouvernementale relève de l’emprise. Il a suffi d’un avis du Conseil, requerrant que l’égalité homme-femme prime sur tout accommodement religieux, pour que Jean Charest amende, quoique modérément, la Charte des droits et libertés. Pas si mal, pour un mouvement moribond. Les commissaires Bouchard et Taylor n’auront qu’à faire avec.
Quelques dates importantes sont nécessaires pour prendre la pleine mesure du lobby féministe, pratiquement aussi déterminant que naguère, l’influence du clergé. En 1966, sur une idée de Simone Monet-Chartrand, est fondée la Fédération des femmes du Québec (FFQ) qui allait devenir, avec 150 groupes-membres et 800 membres individuelles, le plus important regroupement voué à la condition féminine au Québec. Comprenant rapidement que le vrai pouvoir de revendiquer passe par l’action politique, ces militantes obtiennent du gouvernement Bourassa la fondation, en 1973, du Conseil du Statut de la Femme, organisme paragouvernemental.
Avec la Santé et la Justice, l’Éducation a été une cible privilégiée du virage féministe. Par l’intermédiaire du Conseil, la FFQ pouvait influencer les politiques en matière d’éducation. À l’époque, la crainte de voir les filles limitées aux professions dites féminines était justifiable. Les stéréotypes des manuels scolaires méritaient d’être revus.
Pourtant, près de 35 ans après la fondation du Conseil, et bien que les filles représentent 60 % des inscriptions universitaires, le virage scientifique, par lequel les féministes anticipaient autant, sinon plus, de femmes que d’hommes dans les métiers non-traditionnels, bat de l’aile. Bien sûr, le nombre de femmes a dépassé celui des hommes dans les facultés de médecine et en recherche biologique.
Une étude du ministère du Développement économique révèle par contre que, non seulement les filles n’ont pas rattrapé leur retard – car retard, il y a – sur les garçons en sciences pures et en mathématiques, mais qu’elles ont régressé en informatique depuis 1992. Cette réalité n’a rien de surprenant si l’on considère que, dès le secondaire, les filles sont minoritaires en formation professionnelle ou dans les options scientifiques. Féminisme ou non, il faudra se faire à l’idée que, tandis que les garçons traînent de la patte en français et en anglais, leurs consoeurs en arrachent toujours en sciences.
Face à l’échec des garçons, deux discours par ailleurs s’affrontent. Le premier remet en cause le système scolaire, dénoncé comme adapté exclusivement aux filles. Le second, étatique, défend ses politiques et préfère voir dans les stéréotypes masculins, les pères absents et les milieux défavorisés, la cause de tous les problèmes académiques des gars. Difficile de ne pas déceler un discours féministe derrière ces lieux communs. Par l’immobilisme qui les sous-tend, de telles positions continueront néanmoins de maintenir les garçons en situation d’échec, tandis que les filles vivront dans l’illusion d’une réussite mur à mur, quand elle n’est que partielle. Dans l’intérêt des uns comme des autres, une remise en question, sans interférences indues, s’impose.
Éducation : séparer le féminisme de l’État… Olivier Kaestlé, Cyberpresse, 8 janvier 2008.
Note : l’animateur Jean Casault, de CFEL-FM, m’avait interviewé à propos de cet article, le 10 janvier 2008, dans le cadre de son émission «Casault, le midi».
[3] La situation est telle que seul des initiatives citoyennes impliquant nos garçons eux-mêmes pourraient sauver le Ministère d’un naufrage autrement irréversible. En voici un exemple :
(...) S'il est exagéré de blâmer les garçons pour l'échec de notre système à les soutenir, les mobiliser à trouver des pistes de solution pourrait s'avérer judicieux. C'est le raisonnement qui semble avoir motivé la Fondation pour hommes, qui vient de lancer le projet pilote « Garçons en action », à l'école secondaire L'Escale, de Louiseville. Mise sur pied en collaboration avec les enseignants, cette initiative prend la forme d'une enquête d'envergure, qui sera effectuée auprès de 300 jeunes.
Ces derniers s'exprimeront sur des sujets aussi préoccupants que les professions, l'engagement communautaire, la santé, les questions sociales et l'amour. Un rapport, inspiré des leurs commentaires, sera remis à la direction. Les recommandations devraient servir à une meilleure intégration des garçons à la vie scolaire.
L'inefficacité – ou l'immobilisme - du milieu de l'Éducation à aider ceux-ci force des initiatives profanes. De tels gestes deviennent apparemment indispensables pour que l'école identifie et tienne enfin compte des besoins d'apprentissage spécifiques aux garçons. Souhaitons que les résultats soient considérés et ensuite applicables à l'échelle provinciale. Ce partenariat inusité n'en trahit pas moins un constat d'échec du système.
Celui-ci a pourtant déjà réparé d'autres failles. Il n'est pas si loin le temps où le ministère de l'Éducation se voyait interpellé par les groupes de femmes qui dénonçaient le sexisme des manuels scolaires et redoutaient que les filles ne manquent le « virage scientifique », qui devait leur assurer davantage de professions d'avenir. Depuis, non seulement les livres sont exempts de sexisme envers les femmes, mais les besoins d'apprentissage spécifiques des filles sont pris en considération du primaire aux études supérieures.
Ainsi, alors que ces dernières représentent 60% des inscriptions universitaires, le programme « Chapeau les filles », les guidant vers les métiers non-traditionnels, ainsi que des mesures aidant les mères monoparentales à poursuivre leurs études, ont été reconduits dans la politique gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nul ne peut prêcher contre la vertu, ni décrier de telles mesures. On pourrait par contre se demander, alors que les garçons sont sous-représentés, pourquoi des programmes adaptés à leur condition n'aient pas encore été envisagés.
Cet exemple — notamment — révèle que notre système ne donne pas les mêmes chances aux garçons qu'aux filles. Alors qu'il s'adapte aux besoins de celles-ci, le milieu de l'éducation tient un discours défaitiste sur les problèmes des gars et s'enlise dans les conjectures. Pas étonnant qu'il ait maintenant besoin d'eux pour lui dire quoi faire...
Des garçons à la rescousse de l’école, Olivier Kaestlé, Cyberpresse, 5 décembre 2007 ; Le Soleil, 8 janvier 2008.
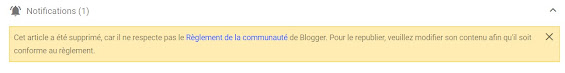



2 commentaires:
Une réflexion venue de France, un peu en marge du sujet, mais un lien serait facile à établir... Les prisons françaises contiennent... 96,3% d'hommes (site du ministère de la justice)! Oui, vous avez bien lu. Quand je pose la question pourquoi, on me répond la crise économique. Donc la crise ne toucherait pas les filles? Là, en général, on me tourne le dos et on s'éloigne en haussant les épaules. Pourtant, l'explication est simple : les éléments féminins de notre société étant devenus hors de prix (et la crise, bien sûr!), il est de plus en plus dur aux éléments masculins d'acquérir le 4X4 et les costards nécessaires à toute séduction. Le vol et le deal (et le viol!) apparaissent alors comme des solutions envisageables. Les filles n'ont pas le problème, il y aura toujours des hommes pour les payer et les servir. Alors, c'est qui les vraies victimes?
Je placerais, bien avant pareille hypothèse, l'explication mise de l'avant par plusieurs à l'effet d'une justice à deux vitesses, l'une, punitive pour les hommes, l'autre, "compréhensive" pour les femmes, qui n'a pas attendu le féminisme pour hanter les cours de justice.
J'en profite pour vous communiquer ce billet de Patrick Scheffer, paru dans Facebook, qui va justement dans ce sens :
Au Canada, les statistiques de beaucoup de crimes sont présentées d'une façon à cacher la
malveillance féminine. Par exemple, les statistiques ne séparent pas le sexe des assassins
d'enfants. En conséquence, je ne peux vous apporter cette information ici. Mais je suis certain
que les statistiques canadiennes ne sont pas bien différentes de celles des États-Unis. Un
traitement favorable pour les femmes n'est pas seulement limité aux meurtres d'enfants. Rose
Cece et Mary Taylor, un couple de lesbiennes à Toronto, décida sur un coup de tête de tuer un
agent de police. S'il s'agissait d'un homme, il aurait été condamné pour meurtre au premier
degré, quoique soient les faits. Sinon les associations de polices à travers le pays auraient été
outragées. Cece et Taylor furent condamnés pour homicide involontaire et personne ne trouva
rien à redire. Au moins furent-elles envoyées en prison. Les femmes sont souvent laissées avec
des condamnations suspendues. Comme le journal Ottawa Citizen l’écrivit si bien : « La
condamnation de la tueuse de Mari Lilian Getkate est une insulte à nos sens naturels pour la
Justice.» La meurtrière elle-même a réagi en disant ceci : « j'étais en extase, je n'y comprends
rien, j'ai pris la vie de quelqu'un et je ne vais même pas en prison. Bien sûr que je suis surprise. »
Une fois encore, la Couronne n’interjeta aucun appel.
Tuer et s'en sortir sans problème.
Cette hésitation à condamner les femmes meurtrières vient de très, très loin. En fait, c'est la
raison pour l'invention du crime d'infanticide au début du XXe siècle. Les jurés refusant de
condamner les femmes assassinant leurs enfants.Une chanson en fut tirée : Lizzy Borden. Ce que
la chanson ne mentionne pas est que, en 1892, un jury de Boston laissa Lizzie sans
condamnation. Une des raisons principales pour cela est que le (là ?)Juge, comme celui du cas
Getkate, dirigea pratiquement le jury pour l'acquittement. Plus ça change...
Une différence fondamentale qui apparaît entre les femmes condamnées à la prison et celles qui
ne le sont pas est sans conteste la cause de la relation familiale.
Seulement deux femmes ont été condamnées pour meurtre au premier degré au Canada. Ivonne
Johnson qui tua un homme qu'elle connut brièvement et Sarabjit Kaur Minhas qui étrangla son
neveu. En d'autres termes, il est permis aux femmes de tuer leur mari, parents ou enfants sans
problème. Bien sûr, il arrive quelquefois un petit incident comme dans les cas de Cece et Taylor.
La discrimination des tribunaux en faveur des femmes n'a pas de limites pour les meurtres. Et
c'est vrai pour tous les crimes. Officiellement, les femmes commettent 15 % des crimes sérieux
au Canada. Un chiffre certainement très sous-estimé. Quel que soit le vrai nombre, elles ne
représentent que 1 % des personnes emprisonnées.
Au Texas, Les statistiques indiquent que les femmes ont plus de probabilité de commettre une
fraude que les hommes. Malgré tout, les hommes ont 10 fois plus de chances d'être mis en
prison pour cette infraction. Il semble y avoir un refus fondamental à admettre que les femmes
sont capables de commettre des crimes. Nous avons tendance à minimiser leurs actes et les
voyons bien trop souvent comme des victimes. Un livre a été écrit à ce sujet sur le cas Johnson.
Son titre est Stolen Life. Devinez à propos de qui, l'auteure pense que la vie a été volée? En tout
cas pas celle de l'homme qui a été tué.
http://www.facebook.com/Patschef/posts/368251413209295
Enregistrer un commentaire