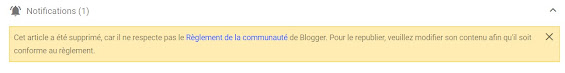Il y a des soupers comme ça. C’est chez moi, devant des fusillis aux moules fumées et une bouteille de Chardonnay, que mon ami Gilles entreprit son étrange récit. Je n’avais pas versé les apéros, qu’il s’exclama : « Un suicide ! Incroyable ! » Désarçonné par ce macabre préambule, je le sommais de préciser sa pensée. Hochant la tête avec un sourire, il me dit qu’il avait appris d’une connaissance le décès d’une amie oubliée, sans obtenir plus de détails. Il avait vainement tenté de communiquer avec le conjoint, jadis très proche de lui. Le frère de cet ancien ami, croisé dans une épicerie, lui avait enfin précisé la cause du décès. S’ensuivit un souper de retrouvailles avec le veuf, le frère et sa femme.
Richard, l’homme éprouvé, y évoqua l’enfance de Marie-Claude, la défunte, expliquant comment un père violent avait fragilisé sa confiance en la vie, ainsi que celle de ses deux frères et de sa jeune soeur. « Elle ne s’est jamais donné le droit de choisir », dit le pauvre, ému. Un diagnostique psychiatrique erroné et un changement de médication inadéquat avaient, selon lui, précipité l’irréparable. Au retour de l’école, la fille aînée trouva sa mère, couchée sur le sofa, les poignets tranchés. Fin de l’histoire.
Toute la vérité ?
Arrivé là, Gilles soupira. J’allais servir les fusillis, espérant changer de sujet, quand il enchaîna : « Il manque quelque chose. » Résigné, je servis le vin. Les explications du veuf lui avaient semblé crédibles, mais insuffisantes. Malgré cette agréable soirée à ressasser de vieux souvenirs avec Richard et son frère, mon ami, de retour chez lui, avait ressenti un inconfort. « C’était un peu comme de jouer au golf, me dit-il. On passe un bon moment, mais on réalise après que les maringouins nous ont bouffé. »
Derrière les blagues en apparence gamines de Richard à son endroit, Gilles avait retrouvé chez ce dernier une attitude qui l’avait jadis indisposé sporadiquement. Il ne s’y était alors jamais arrêté. Richard avait tenté de le déstabiliser. Sans arrêt. Il cachait cette fois de la rancœur. C’était en effet mon ami Gilles qui avait naguère pris ses distances de son copain, après qu’un courtier sans scrupule l’eut calomnié aux yeux de Richard et de Marie-Claude pour mieux les rouler. L’escroc soulagea le couple de 15 000 $. Défiant toute logique, Richard avait, malgré ce fait, « décidé » de douter de Gilles.
Un seul vrai ami
« Manipulation ! », décréta mon ami. Oubliant mes fusillis, il m’expliqua que son amitié avec Richard remontait à l’adolescence. À partir de 25 ans, Gilles, après ses études, travailla, se maria et noua d’autres amitiés, dont la nôtre. Un jour, Richard lui dit que, dans la vie, on n’avait qu’un seul vrai ami. Pour être heureux, il ne fallait à ce dernier que Marie-Claude, ses filles… et Gilles. Exclusivement. Mon comparse n’avait jamais réalisé la possessivité de Richard. Ni sa manie de gruger l’estime de soi d’un être cher par des commentaires insinuants et réducteurs, pour mieux se l’asservir.
Gilles, téflon, avait fini par tourner la page, excédé par le présumé scepticisme de Richard, en fait simulé et voulu, sur sa crédibilité. Marie-Claude, viscéralement indécise et manoeuvrable par son insécurité même, avait vécu quant à elle suivant les diktats de son homme, cuisinant selon Montignac, se saturant l’esprit de pop psycho, choisissant ses vêtements selon telle pseudo science des couleurs, allant même jusqu’à exercer la même profession que son « gourou ». « Richard était une secte à lui tout seul », soupira Gilles. Pas de doute, Marie-Claude, sous influence, ne s’était jamais donné le droit de choisir.
Désormais, ni père, ni conjoint, n’allait décider pour elle.
Ce Rétrolivier est un récit paru dans Cyberpresse le 22 février 2008.