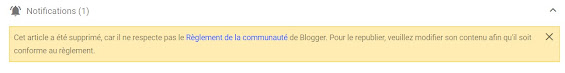|
| Nicholas, victime |
 |
| China Arnold |
On a beau se dire que des meurtres ou sévices particulièrement cruels infligés par des mères à leurs enfants étaient moins médiatisés que ceux commis par des pères, davantage de nuances et de discernement, de la part d’un présumé spécialiste, auraient été de mise, afin d’éviter des stéréotypes réducteurs. Cette perception aussi erronée qu’enracinée fait peu de cas de meurtres crapuleux récents. Mentionnons celui commis par China Arnold, qui a tué sa fille d’un mois au micro-ondes à Paris en 2005, après avoir nié au père sa paternité, cet autre, perpétré en 2008, également en France, par Coralie Gossiaux, qui avait frappé et tué son beau-fils en l’ébouillantant, et cette boucherie, imputée en 2008 à une Brésilienne, accusée d’avoir assassiné ses deux enfants à la scie électrique. Où se situe la « motivation altruiste » chez de telles brutes ?
 |
| Coralie Gossiaux |
Et c’est sans compter la violence familiale infligée par les mères. Que dire, en effet, de cette femme de Wickham, condamnée en 2008 à quatre ans de prison ferme, après avoir torturé pendant 10 ans sa fille, battue à coup de balai, ébouillantée à l’eau chaude, brûlée au tisonnier, en plus de se voir forcée de manger des aliments avariés et des excréments d’animaux ? Que penser de cette autre, accusée en 2007 d’avoir tenté de noyer sa fille au cours d’une dispute ? La marâtre brutalisait cette dernière depuis 1988, ainsi que cinq autres de ses huit enfants, en les frappant avec des bâtons de hockey, des chaussures, des tablettes, des ceintures et du linge mouillé. Est-ce par tact maternel qu’une Montréalaise, condamnée en 2005, avait si sévèrement maltraité ses trois enfants pendant 18 ans en les frappant à coup de pied, de poing, de bâton, et même à l’aide d’un manche de marteau, allant jusqu’à s’asseoir à califourchon sur leur poitrine en leur bloquant la bouche pour les punir d’avoir pleuré ?
 |
| Menacé par le génocide rwandais |
D’autres femmes jugent à propos d’intoxiquer leur enfant, comme cette Britannique de 31 ans, condamnée à neuf ans de prison en 2006 pour avoir fourni du crack et de l’héroïne à son fils de neuf ans, ou cette Américaine, âgée de 18 ans, arrêtée la même année, après que sa fillette d’un an ait été testée positive à la cocaïne. Leur « motivation altruiste » m’échappe toujours.
Il serait intéressant de recueillir les commentaires de M Marleau, à la lecture de Not so innoncent : when women become killers, une enquête publiée en 1995 par African Rights. On y apprend que, tandis qu’un nombre impressionnant de femmes ont participé au génocide rwandais, tuant de leurs propres mains des enfants, achevant des malades à la machette, immolant au pétrole des innocents, poursuivant des Tutsis avec des battes de baseball transpercées de clous, plusieurs mères et grands-mères refusaient de protéger leur progéniture en les exposant aux pires violences. Étonnante façon « d’éviter des souffrances réelles, anticipées ou amplifiées »…
Mélanie Alix : la palme du sordide
 |
| Mélanie Alix |
Au chapitre des infanticides crapuleux commis par des mères ces dernières années, la palme du sordide revient de facto à Mélanie Alix, reconnue coupable en 2005 du meurtre au premier degré de son fils d’un an, Matisse, commis en 2003, et de celui de sa propre mère, perpétré en 2001. Les deux événements étaient survenus au cours d’incendies domestiques criminels mais en apparence accidentels, le plus récent, allumé à Saint-Blaise et le plus ancien, à L’Acadie. Le mobile était de toucher des primes d’assurance-vie. Les troublantes similitudes entre les deux cas mirent la puce à l’oreille des enquêteurs, au lendemain du second feu.
 |
| Matisse, victime |
M Marleau s’est sans doute senti sécurisé d’apprendre que la meurtrière devait affirmer, au terme d’un interrogatoire policier de six heures, que si elle avait tué son fils et tenté d’assassiner sa fille, qui avait pu se sauver, c’était pour ne pas les confier à son ex-conjoint, Stéphane Leblanc, afin qu’il ne leur fasse pas de mal. Sans doute faut-il conclure que cette explication tient tout autant la route pour le meurtre de sa mère… Alix avouera par ailleurs avoir mélangé de puissants sédatifs dans le biberon du bébé après les avoir fait bouillir. Elle précisera également avoir utilisé l’huile d’une friteuse pour provoquer l’incendie.
Au risque de causer quelque chagrin au chercheur de Philippe-Pinel, le portrait de Mélanie Alix, brossé par ses connaissances et voisins, lors de son procès, ne cadrait pas avec ses vues angélistes. Elle a été unanimement dépeinte comme une femme méchante, dépressive, froide et agressive. Même la seule voisine à avoir été son amie, qui avait gardé son fils, ne croyait plus en son innocence. Ses autres voisins la détestaient : elle les engueulait régulièrement et leur envoyait la police sans motif. Une collègue l’avait dépeinte comme déplaisante, dominatrice, nonchalante et mal dans sa peau. « Personne ne pouvait la tolérer », devait-elle conclure. Une employé du restaurant fréquenté par Alix et citée par Le Journal de Montréal la décrivait ainsi : « Elle n’était pas maternelle. Elle ne parlait pas bien devant les enfants. Elle traitait sa fille de maudite vache. Elle n’était pas patiente. »
Dernière touche à ce tableau calamiteux : Alix disputait à son ex-conjoint la garde des enfants avant le drame. Leblanc l’ayant quittée, tous le moyens ont été employés pour lui pourrir l’existence : plainte d’agression sexuelle, de séquestration et de menaces de mort, finalement retirée après incarcération. Personne dans l’entourage d’Alix n’avait prêté foi à de telles allégations. La sociopathe fit également perdre deux emplois à son ex, à force de le harceler au téléphone. Elle devait aller jusqu’à incendier la Jeep de Leblanc, par jalousie, et sa propre auto, cette fois encore pour toucher la prime d’assurance.
Les témoignages fantaisistes et contradictoires d’une accusée aussi amorale que mythomane contribuèrent à sa condamnation à perpétuité pour les meurtres de son fils, de sa mère, tentative de meurtre sur sa fille et deux incendies criminels. La cupidité a été le seul mobile évoqué. La volonté de priver le père de ses enfants en les tuant, pathologie appelée complexe de Médée, aurait pu être considérée dans une société beaucoup plus avancée que la nôtre quant à la reconnaissance de déviances féminines.
 |
| Au centre, Cathy Gauthier |
Je ne voudrais cependant pas laisser M Marleau sur une note fâcheuse en laissant entendre qu’il se trompe sur toute la ligne. En appliquant son analyse, je trouve plausible que Cathy Gauthier, cette Saguenayenne qui a tué ses trois enfants avec la complicité de son mari après avoir conclu avec lui un pacte de suicide, ait pu agir ainsi pensant les protéger d’une vie intenable. J’estime vraisemblable que Guy Turcotte, le cardiologue de Piedmont qui a assassiné ses deux enfants au couteau ait pu agir par rancoeur. De tels drames arrivent, pour les raisons invoquées par Marleau, sans pour autant que celles-ci constituent une tendance prévisible. Établir cette distinction constitue la différence fondamentale entre l’identification de problématiques et la propagation de stéréotypes.