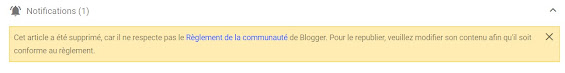|
| Michelle Courchesne |
Manon Bernard, présidente de la FSE, déclarait : « Il y a énormément de colère dans nos rangs en ce moment en lien avec ces fausses allégations et ces accusations. Les enseignants reçoivent durement un message extrêmement démotivant qui fait de l’enseignement une profession de plus en plus à risque. Chaque geste posé envers un élève, aussi nécessaire soit-il pour l’enseignant, peut maintenant avoir des conséquences graves, et même briser des vies et des carrières. Pourtant, il y a une énorme différence entre exercer son autorité en classe dans le cadre de son travail et poser un geste violent envers un élève. Nous souhaitons que ce message soit compris par tous les intervenants de notre milieu et qu’au-delà des beaux discours que les dirigeants scolaires tiennent sur notre profession, ils nous appuient concrètement dans l’exercice de notre travail. »
 |
| Manon Bernard |
Mme Bernard affirmait de plus que le fléau des fausses allégations était en hausse depuis 10 ans et, plus particulièrement, depuis les cinq dernières années. Jean Drury, avocat en droit criminel, le confirmait, après avoir défendu six accusés de voies de fait en un an et demi, une nette augmentation en regard des années antérieures. « Au Québec, accuser un enseignant au criminel est un jeu d’enfant », renchérissait-il. Selon le psychologue Hubert Van Gijseghem, les jeunes, sur sensibilisés, ne font pas toujours la part des choses : « Un simple toucher peut se muer en attouchement sexuel, une contention physique en voies de fait. » La préadolescence n’arrange rien, précisait-t-il : « Rumeurs malveillantes, complots, vengeances : les faits sont souvent déformés intentionnellement par le jeune qui défie l’autorité ou découvre sa propre sexualité. »
Voilà un discours qui va à contre-courant d’une attitude étatique de « tolérance zéro » fortement conditionnée par certains lobbys. Allez défendre les points de vue qui précèdent devant le Regroupement québécois des Calacs, pour qui la présomption d’innocence demeure un fâcheux irritant dans la lutte que ces militantes prétendent livrer aux agressions sexuelles, et vous pourrez mesurer toute la résistance qui attend les enseignants dans leurs revendications légitimes.
« D’un côté, on accuse les professeurs de faire preuve de laxisme en classe, avait dénoncé Mme Bernard, mais d’un autre côté, quand ils interviennent auprès d’un élève, ils s’exposent à une poursuite au criminel. On souhaite être davantage soutenus pour exercer notre autorité. » Voilà pourquoi la FSE interpellait le gouvernement québécois afin qu’il revoie la procédure, découlant d’une entente multisectorielle conclue en 2001, qui régit toujours les plaintes déposées contre les professeurs et qui fait que tout professionnel « ayant un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont ou peuvent être considérés comme compromis a l’obligation de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse ».
Compte tenu de la réputation d’excellence de cet organisme décrié de toute part, il ne faut pas se surprendre des inévitables dérives engendrées par ses redoutables excès d’efficacité, de plus en plus dénoncés comme étant conditionnés par une approche féministe radicale. Faut-il s’étonner si la plupart des victimes de fausses allégations sont des hommes ?
Les garçons aussi écopent.
 |
| Université de Nipissing |
Une récente étude de l’Université de Nipissing, en Ontario, révèle qu’un enseignant masculin sur sept a été victime de fausses allégations et que, lorsque des jeunes portent plainte pour sévices, rien n’est prouvé dans trois cas sur quatre. Cette calamité, Jon Bradley, professeur à la faculté d’Éducation de l’université McGill, la dénonce depuis quelques années : « S’ils quittent leur emploi à la suite de calomnies, tout le monde est perdant : eux, la société et les enfants. »
Au-delà des longues études, des conditions de travail discutables et de la surreprésentation féminine, contextes qui ont toujours prévalu, faut-il voir dans cette menace, qui plane plus que jamais sur leur avenir, le facteur déterminant dans la chute brutale, ces dernières années, du nombre d’enseignants masculins de 29 à 22 % ? Poser la question, c’est y répondre.
Les profs masculins ne sont pas les seules victimes des fausses allégations. Les garçons subissent indirectement le contrecoup de leur pénurie. Même si le concept de leur influence sur la réussite scolaire des gars ne fait pas l’unanimité, il faut au moins envisager l’hypothèse que leur absence accentue une problématique à laquelle on ne semble trouver aucune solution. Alors qu’un garçon sur trois ne termine pas son secondaire et que, de l’aveu même de la nouvelle ministre de l’Éducation, Line Beauchamps, son ministère est marqué – ou devrait-on dire gangrené ? - par une guerre d’idéologies, il importe plus que jamais de trouver des solutions concrètes et rapides afin d’éliminer à la base les irritants qui provoquent l’exode des profs masculins.
 |
| Égide Royer |
Convaincu de leur influence bénéfique sur les garçons, le pédagogue Égide Royer préconise la discrimination positive afin d’augmenter leur participation, proposition qui suscite l’enthousiasme des directions d’école et les réserves des syndicats. Pour bien intentionnée que se veuille à prime abord cette mesure, il faudrait s’interroger sur son efficacité à l’embauche si, en contrepartie, les inscriptions masculines en enseignement continuent de stagner. Pertinente, une tournée de sensibilisation à l’automne, comme l’anticipe la ministre ? Discrimination positive et valorisation de la profession ont déjà été combinées afin d’augmenter les inscriptions des femmes en ingénierie, sans que ces dernières ne dépassent 11 % des membres de cette profession.
À la différence de celles-ci, les enseignants masculins, déjà plus nombreux, l’ont été par le passé encore plus. Faudra-t-il à nouveau fouiller, disserter, décortiquer, soupeser et cogiter ad nauseam afin d’identifier les ressors profonds qui, dans la psyché masculine, compromettent le désir d’enseigner ? En attaquant de front la problématique des fausses allégations, la ministre Beauchamps ferait coup double : tout en faisant montre de courage politique, elle contribuerait à enrayer de graves injustices et stimulerait ensuite, par des effectifs masculins accrus, la réussite des garçons. Elle serait bien la première ministre de l’Éducation à arriver à des résultats concrets. Son action devrait cependant obtenir l’appui et la collaboration du ministre de la Justice.
 |
| Jon Bradley |
Une telle attitude demande un sérieux coup de barre. Laissons, dans cette perspective, au professeur Bradley le mot de la fin : « Les enquêteurs trop zélés, les jeunes qui ont manifestement menti, les parents qui en rajoutent sur l’Internet : tous doivent être sanctionnés. Il faut les dissuader d’agir ainsi. Pour l’instant, on voit des gens dont la réputation et la vie ont été ruinées et qui ne peuvent même pas compter sur des excuses. »